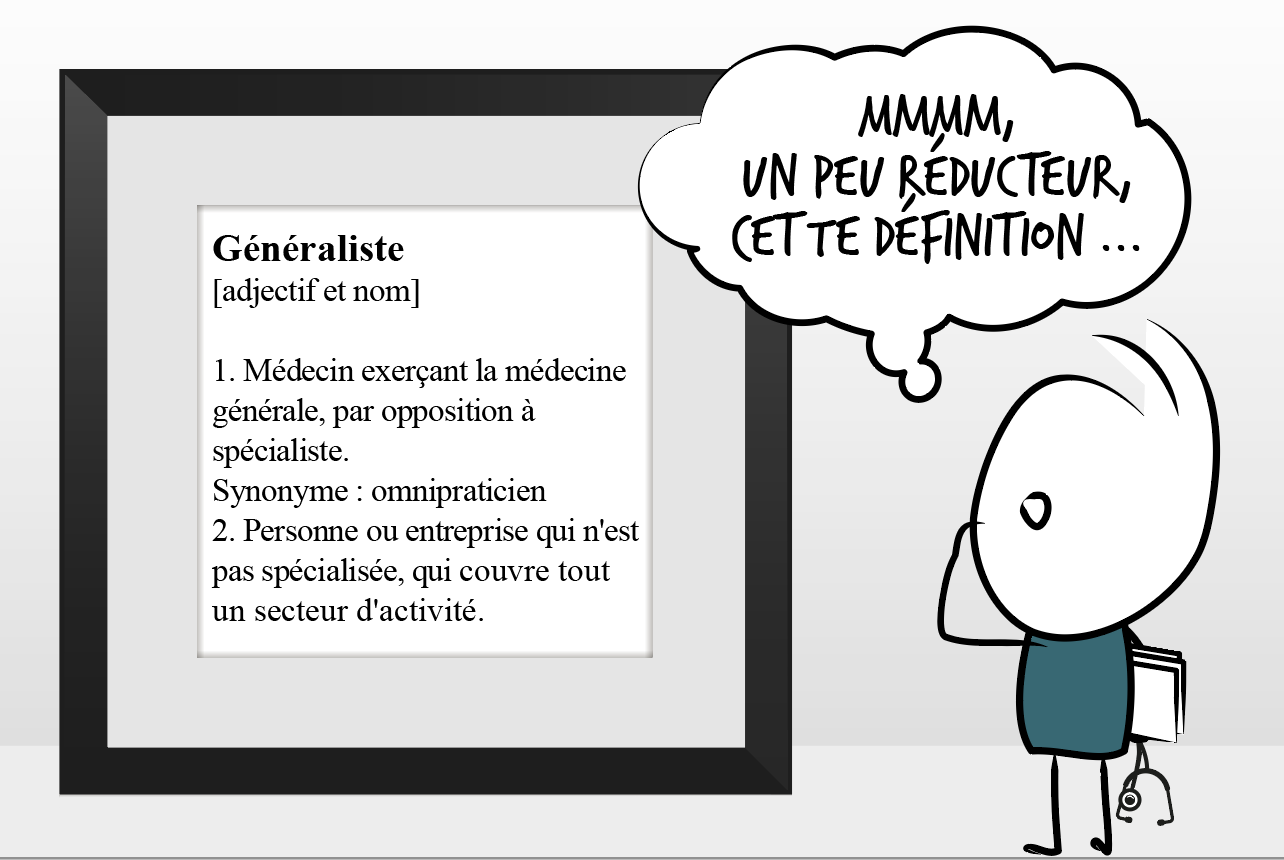
 .Un billet d’humeur du Dr Lawrence Cuvelier, président du GBO/Cartel, publié le 30/01/2025.
.Un billet d’humeur du Dr Lawrence Cuvelier, président du GBO/Cartel, publié le 30/01/2025.
Les billets repris dans la rubrique « Grains à moudre » témoignent des opinions personnelles de leur auteur (et n’engagent que lui), sans nécessairement refléter la position du GBO/Cartel.
La neuvième édition complète du dictionnaire de l’Académie française vient de paraître. Près de 40 ans pour aller de A à Z ! Que dit-elle de nous ?
Généraliste : Dont les activités ou la compétence s’étendent à l’ensemble d’un domaine, par opposition à Spécialiste. Un médecin généraliste ou, subst., un généraliste, qui exerce la médecine générale (on dit aussi Omnipraticien).
Aussi généreux que vague ! Je décidai de chercher une réponse plus concrète à la question « qu’est-ce qu’un médecin généraliste ? » en interrogeant la vox populi. Les réponses entendues proclamaient sur un ton ferme et définitif : « un vrai généraliste doit savoir faire ceci (ou cela) », « on n’est pas un vrai médecin de famille si on ne connaît pas ceci (ou cela) ». Ces ceci et cela, du plus trivial au plus poétique, me plongeaient dans un océan de perplexité. L’idée me vint de me référer à mon diplôme. « Docteur en médecine, chirurgie et accouchements ». Les seuls accouchements auxquels j’ai assisté n’ont concerné que ma famille et, quant à ma dextérité bistouri en main, je préfère la passer sous silence.
Ou alors faut-il que je définisse ma profession par opposition à celle de spécialiste ? Hélas, le spécialiste connaît son champ de compétence, il appréhende celui des spécialités connexes mais n’a qu’une vague idée des compétences des généralistes que, du haut de sa montagne, il voit parfois comme un petit peuple grouillant et disparate se démenant dans un marais d’incertitude. Pas très concluant ! Difficile aussi de comparer mon activité avec celles de mes prédécesseurs : non seulement l’évolution des connaissances et des techniques a transformé le métier mais c’est jusqu’à notre rôle qui se transforme. Mes patients ne purent m’apporter davantage de lumière ! Abreuvés d’informations médicales sensationnelles, ballottés entre promesses des marchand de poudre de Perlimpimpin et prouesses des centres universitaires, ils ne pouvaient évaluer l’impact souvent moins triomphalistes des progrès médicaux sur leur propre santé et ne manifestaient une certaine compréhension du rôle du généraliste que quand les choses se compliquaient et que l’accumulation des pathologies se confrontait avec l’ensemble des conditions de vies, ce moment crucial où on passe d’une équation à une inconnue à un calcul matriciel et où l’arbitrage des priorités doit conjuguer la science avec le bon sens.
Le bon MG est celui qui connaît ses limites et qui, en conséquence, peut travailler avec d’autres confrères, en groupe ou en solo, avec les autres partenaires de 1re ligne ainsi qu’avec les spécialistes. Aujourd’hui, notre système de santé ne fonctionne pas de manière optimale parce qu’il demeure trop cloisonné. Cassons les barrières !.
Protéiforme ?
Finalement, je me suis dit que celui qui était le mieux placé pour définir un « médecin généraliste », c’était … un médecin généraliste. J’en avais un sous la main : moi. Par exemple, travaillant au centre de Bruxelles avec une population défavorisée comprenant des immigrés et des usagers de drogue, j’ai rencontré beaucoup de pathologies considérées comme « marginales » : la tuberculose qui n’avait pas disparu ou l’hépatite C qui faisait des ravages chez les héroïnomanes. Je me suis familiarisé avec ces pathologies et je n’ai rapidement eu aucune difficulté à maîtriser seul ces maladies avec la collaboration d’un encadrement paramédical spécifique qui existe à Bruxelles. Cela ne signifie pas que tous les généralistes doivent acquérir ce type de compétence, mais qu’être généraliste, c’est pouvoir mettre un savoir médical de base (de bon niveau tout de même) au service des patients et des circonstances, là où on exerce. Et qu’être généraliste, c’est aussi connaître ses limites. Il n’y a aucun problème à ce qu’un généraliste rarement ou jamais confronté à des cas d’hépatite C dans sa patientèle n’en maîtrise pas le suivi. Ce qui est par contre regrettable, c’est quand certains praticiens se permettent de pontifier sur ce qu’ils ne connaissent pas. Ainsi j’ai dû plus d’une fois rassurer un patient en larmes, guéri de son hépatite au terme d’un lourd traitement et auquel un généraliste mal informé ou un spécialiste d’un autre domaine avait annoncé, sur base d’une sérologie, qu’il était réinfecté. Il faut savoir qu’un patient guéri de l’hépatite C portera toujours les anticorps de cette maladie et que le seul test fiable est une PCR. Connaître ses limites …
On le voit, les avis sont partagés quant à ce que doit connaître et savoir faire un “vrai” généraliste. Certains, en Europe continentale, prônent une formation encyclopédique alors que les pays anglo-saxons privilégient une formation plus pragmatique. Dans mon apprentissage (d’accord, ça date …), on insistait pour que chaque MG dispose d’un microscope et d’une centrifugeuse pour lire un sédiment. Combien de patients aurions-nous dû avoir pour acquérir une expertise en la matière ? Il est vrai qu’à l’époque, notre enseignement était dispensé par des spécialistes peu informés (si pas méprisants) quant au travail réalisé en médecine générale.
… la distinction entre les cerveaux philosophiques et les autres, ce serait que les premiers veulent être justes tandis que les seconds veulent être juges. (Nietzsche, Humain trop humain)
Autres exemples d’avis divergents parfois très stigmatisants : la visite à domicile et les soins de santé mentale. Certains décrètent ces pratiques indispensables en MG, d’autres qu’elles sont inutiles. Amis confrères, amis censeurs, pourrait-on envisager des avis plus mesurés ? Les visites à domicile m’ont entraîné à tirer le maximum d’un examen clinique évidemment moins performant qu’au cabinet mais, en revanche, elles m’ont permis de comprendre ce que vivaient mes patients, leurs espoirs, leurs contraintes et tout le contexte dans lequel s’incarnait leur pathologie. J’en connais qui se présentent de façon très honorable en consultation alors qu’ils vivent dans un capharnaüm invraisemblable. Je me souviens d’une dame, rescapée de camp de concentration et toujours tirée à quatre épingles, qui partageait son minuscule appartement avec 17 chats. Autre intérêt, une visite régulière du généraliste peut avoir un effet structurant et dans bien des cas éviter l’institutionnalisation dans une maison de repos. Elle est également irremplaçable pour les personnes à mobilité réduite ou très âgées. Bien sûr, il est parfaitement acceptable que certains médecins ne pratiquent pas de visites à domicile, pour des raisons personnelles ou parce qu’ils souffrent eux-mêmes d’invalidité. Qu’un généraliste pratique en chaise roulante ne fait évidemment pas de lui un mauvais généraliste. Nous sommes tous différents. Dans le domaine des souffrances psychiques, certains médecins ont une intelligence émotionnelle plus développée et devront moins souvent référer à des psys que ceux qui ne se sentent pas à l’aise avec ce type de problème. Mais jouir d’une plus grande capacité d’empathie par rapport à d’autres fait partie de compétences qui reflètent plus un trajet de vie que des performances universitaires. Là encore, il n’y a pas de bons et mauvais généralistes, mais il est insupportable que des jugements sur la façon de pratiquer de ces deux types d’omnipraticiens fassent l’objet de condamnation sur la place publique.
En conclusion, je dirai qu’aucun médecin n’est performant dans tous les domaines, et que vouloir encager le généraliste dans une définition est dommageable pour notre système de santé. Le bon médecin est celui qui connaît ses limites et qui en conséquence peut travailler avec d’autres confrères, en groupe ou en solo, avec les autres partenaires de première ligne ainsi qu’avec les spécialistes. Aujourd’hui, notre système de santé ne fonctionne pas de manière optimale parce qu’il demeure trop cloisonné. Cassons les barrières !


