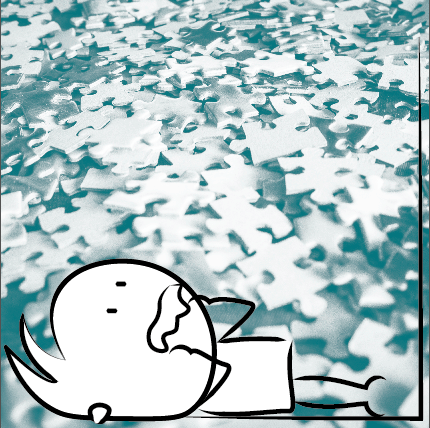
Parlons plutôt de syndémie
Un billet d’humeur du Dr Lawrence Cuvelier, vice-président du GBO
publié le 23/12/2021
Ne devrait-on pas requalifier la pandémie de « syndémie » ? Soit un phénomène qui par intrication d’affections, de facteurs biologiques mais aussi environnementaux et sociaux (comme l’isolement), va accroitre les répercussions qu’ont ces affections sur les gens. Dans le champ du chronique, le bilan syndémique pourrait faire doubler* les statistiques de morbi-mortalité.
Dans un parc naturel d’Afrique du Sud, les guépards avaient l’habitude de s’ébattre librement à proximité directe des touristes qui venaient les voir. Faute de touristes au début de la pandémie, les fauves ont perdu cette habitude, on n’en voyait plus que quelques-uns. Ils l’ont retrouvée après un an. Cet exemple, largement exotique, démontre que le covid a des répercussions multiples, pas uniquement au niveau médical – qui rejaillissent en l’occurrence sur d’autres espèces que l’homme. C’est pourquoi Richard Horton, directeur du Lancet, a décidé de qualifier la crise sanitaire de « syndémie »**. C’est-à-dire que cette crise se caractérise par un entrelacement de maladies, de facteurs biologiques et environnementaux qui, par synergie, aggrave les conséquences de ces maladies sur une population. Au-delà des pathologies proprement dites, les médecins ont parfois dû résoudre des problèmes quasi insolubles.
Renoncements et reports
Ainsi a-t-on vu, depuis le début de la pandémie, un accroissement notable de la mortalité par hépatite C dans le monde. Comme pour toutes les affections chroniques, l’accès aux soins s’est restreint. Les soins chroniques, ou sub-chroniques, peuvent être différés de quelques jours ou de quelques semaines. Mais quand les délais se prolongent, les conséquences deviennent dramatiques.
Dans bien des cas, les maladies chroniques ont des caractéristiques pernicieuses. Soit elles sont asymptomatiques, comme le diabète, l’hypertension ou l’hépatite C, soit les patients s’habituent aux handicaps qu’elles entrainent, par exemple à la réduction de mobilité pour les patients atteints de BPCO, de polyarthrose ou de fragilité due au grand âge. Les patients qui ont un statut socio-économique peu élevé et une compréhension limitée des risques et de la gestion de ceux-ci (ce qu’on appelle la littératie en santé) sont évidemment les plus exposés aux risques de complications.
Des consultations spécialisées de suivi, des soins d’accompagnement comme la kinésithérapie ou l’ergothérapie, se sont réduits avec l’arrivée du covid. Les patients ont différé leur venue chez le généraliste, entre autres par crainte d’être contaminés, et, plus récemment, par crainte de le déranger et de contribuer à surcharger son agenda…
Il est difficile de quantifier exactement le phénomène, mais je ne serais pas étonné qu’après coup, on se rende compte que le bilan syndémique fasse doubler ou tripler les statistiques de morbi-mortalité. Les estimations sur les troubles de santé mentale seront sans doute plus édifiantes encore, mais aussi plus compliquées à analyser du fait de l’intrication possible avec la maladie elle-même, en particulier le covid long.
Le bilan de la crise sera par ailleurs compliqué de par les conséquences de l’épuisement du personnel et des burn-out. Les absences ont provoqué une diminution d’accès aux soins, faute de bras pour dispenser ceux-ci.
Le médecin pour seul soutien
Si l’on considère que la santé recouvre un vaste éventail de paramètres dont l’isolement mais aussi une certaine autonomie, nombre de patients, au cœur de la crise, quand les guichets des banques et des administrations étaient fermés, dépendaient de l’appui de quelques intervenants pour accéder à des services essentiels. Parfois, selon les situations familiales, les plus esseulés n’ont pu tabler, comme uniques ressources fiables, que sur leurs infirmières à domicile ou leurs médecins.
C’est ainsi qu’une médecin généraliste se trouvait en charge d’une patiente âgée, présentant un léger déficit cognitif mais en mesure de rester chez elle. Elle ne pouvait toutefois pas faire confiance à son fils qui l’avait déjà escroquée. Sa généraliste se chargeait dès lors de lui apporter l’argent dont elle avait besoin. Malheureusement, quand sa carte bancaire vint à expiration et que la banque lui en expédia une nouvelle, la patiente crut à tort qu’il s’agissait d’une publicité. Impossible de contacter un quelconque employé pour régler le problème, tout devait se faire en ligne. Pendant quatre mois, la praticienne lui avança de quoi vivre, jusqu’au jour où la dame fut invitée à répondre – par téléphone – à un questionnaire de sécurité. Sa médecin était présente à ses côtés pour lui souffler les réponses, le stress et l’âge ne permettant pas à la vieille dame d’être suffisamment précise. Tout rentra alors dans l’ordre.
On peut s’indigner, dire : « ce n’est pas au médecin de faire cela ! » C’est exact. Mais qui s’en charge, alors, face aux bureaux vides et aux formulaires en ligne parfaitement inadaptés dans de pareils cas ? Dans la tranche de vie professionnelle relatée ci-dessus, la patiente n’est pas précarisée, ne bénéficie pas d’une aide sociale, mais est totalement livrée à elle-même bien qu’elle ait un fils. Les solutions imaginées par les services sociaux, les administrations, banques et autres services essentiels ne tiennent compte ni de la fracture numérique ni des cas particuliers.
Des vulnérabilités à étudier
Combien pourrait-on dénombrer de victimes silencieuses de ce type de situations ? Combien de cas de désespoir non comptabilisés menant à la mort, parfois, ou à tout le moins à une dégradation irréversible de l’état de santé, souvent ?
Nous, les MG, sommes là pour en témoigner. D’autres intervenants de première ligne aussi. Prenons le temps d’étudier ces vulnérabilités et d’y trouver certains remèdes qui n’impliquent pas uniquement les travailleurs de la santé.
Dr Lawrence Cuvelier
————————————————————
* « The Commission described how the availability of affordable, cost-effective interventions over the next decade could avert almost 5 million deaths among the world’s poorest people. And that is without considering the reduced risks of dying from COVID-19 ». Richard Horton, « Offline: COVID-19 is not a pandemic », The Lancet, vol. 396, no10255, 26 septembre 2020, p. 874 (ISSN 0140-6736 et 1474-547X, PMID 32979964, DOI 10.1016/S0140-6736(20)32000-6
** Une syndémie caractérise un entrelacement de maladies, de facteurs biologiques et environnementaux qui, par leur synergie, aggravent les conséquences de ces maladies sur une population. Le terme a été développé par Merrill Singer dans le milieu des années 1990. Source : Wikipédia
