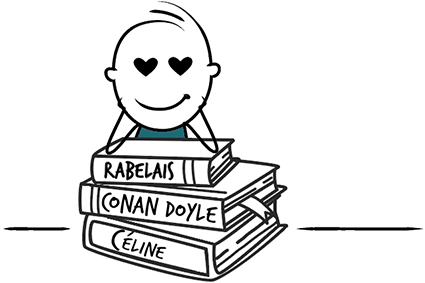
MÉDECINE ET LITTÉRATURE
.
Un billet d’humeur du Dr Lawrence Cuvelier, Vice-Président du GBO/Cartel, publié le 13/01/2023.
Tout médecin est confronté à des milliers de récits qui pourraient donner matière à d’innombrables romans, mais tous ne se sont pas fait écrivains. Pourtant ces récits offrent ce “je ne sais quoi” cher au philosophe Jankélévitch qui fait le charme de notre profession. On peut le regretter car l’écriture « littéraire » permet de traduire une réalité complexe qu’un dossier médical ou un résumé électronique truffé de classifications internationales ne peuvent que dessécher. Ces médecins écrivains, même ceux qui ne sont plus guère lus de nos jours, apportent quelque chose à la réflexion médicale. Quelques exemples.
Un idéal à la dérive
Archibald Joseph Cronin, écrivain écossais fort prisé en Europe au milieu du siècle dernier et aujourd’hui encore dans le monde anglo-saxon, a suscité la vocation de médecin de pas mal d’entre nous à cette époque. Dans « Le destin de Robert Shannon » (publié en 1948), il décrit avec justesse les débats éthiques qui divisaient un monde médical où la tradition se heurtait aux progrès fulgurants de la médecine. « La citadelle », publié en 1937, montre le parcours d’un médecin exerçant parmi les mineurs du pays de Galles. Il devient militant d’une médecine sociale puis quitte les régions pauvres de l’Ouest Britannique pour s’installer à Londres et, bribes par bribes, lâche ses convictions médicales et sociales pour pratiquer une médecine lucrative et de peu d’intérêt scientifique, jusqu’à ce qu’il remette en cause la vacuité de sa nouvelle vie guidée par le matérialisme. Ce livre évoque bien des itinéraires de nos jeunes confrères, virulents dans la jeunesse et cyniques une fois que les cheveux grisonnent. Écrit avant la guerre, il a fortement contribué à l’élaboration du National Health Service (NHS), le système de santé britannique, à la fois critiquable et très performant.
Une médecine de qualité ne peut se concevoir sans la richesse d’une vraie rencontre, dans toute son humanité.
Élémentaire, Docteur Watson
Si l’ophtalmologue Conan Doyle n’avait pas vu son cabinet désespérément vide en 1890, peut-être n’aurions jamais connu les enquêtes de Sherlock Holmes où un autre aspect de la médecine est mis en valeur : celui de l’observation méticuleuse d’indices d’où émerge la vérité. La mise en scène de la sémiologie médicale y est poussée jusqu’à l’invraisemblance, et pourtant combien de fois, comme médecin, n’avons-nous pas découvert la vérité à partir d’un détail apparemment insignifiant ? Nous avons tous nos trucs pour recomposer un paysage sous le couvert d’une question anodine. Demander à un patient s’il a des frères et des sœurs peut permettre, à sa façon de répondre, de voir s’il a vécu dans un climat harmonieux, ou si ses premières années ont été perturbées. De la même façon, poser une question sur le sommeil mettra en lumière quantité de problèmes de santé physique (nycturie) ou mentale. Un patient qui relate de mauvaises vacances a peut-être des problèmes conjugaux.
Un autre auteur, non médecin, relate avec beaucoup de pertinence le parallèle entre une enquête policière et le travail du médecin. Il s’agit de Georges Simenon, qui décrit avec une précision clinique les motivations et la vie intérieure des protagonistes d’un drame. Le professeur Sokal, ancien doyen de la faculté de médecine, affirmait que la médecine pouvait s’apprécier à l’aune de Simenon et de Dostoïevski.
La dive bouteille et la substantifique moelle
Ces deux termes sortent de l’imagination fertile d’Alcofribas Nasier, pseudonyme de François Rabelais, qui estimait qu’un médecin honorable ne pouvait pas écrire sous son vrai nom des textes séditieux et grivois. Malgré l’appui de François Ier et d’Henri II, ses ouvrages furent impitoyablement censurés par la Sorbonne. Rabelais fut d’abord un médecin assez sérieux, ensuite un religieux en conflit avec les autorités ecclésiastiques, ce qui ne l’empêcha point de devenir secrétaire et médecin du pape Clément VII pendant quelques mois en 1534. Ce paradoxe vivant d’une époque troublée, apôtre de la libre pensée à la suite d’Erasme (L’éloge de la folie), fut un pourfendeur des hypocrisies et du conformisme. Est-ce sa position de médecin qui voit la vie réelle des gens et non ce que les autorités et les élites imaginent qui lui a donné tant de verve ? En tout cas, il nous incite à porter témoignage de la réalité.
Médecin des pauvres et collaborateur
Du côté obscur de la force, que penser de ce médecin, immense écrivain issu d’un milieu modeste, sensible au sort des plus démunis, marqué par la violence de la première guerre mondiale (durant laquelle il fut blessé en octobre 14), qui sombra dans un délire antisémite, et qui attira la sympathie des communistes (au point qu’Elsa Triolet l’invita en URSS. Il en revint farouchement anticommuniste et deviendra pro-nazi et collaborateur). Comment comprendre le paradoxe de l’humanisme médical réel de Louis-Ferdinand Céline qui contraste avec son cynisme et son pessimisme violent ?
La médecine n’est pas que du roman …
À travers les siècles, ces exemples littéraires montrent que l’activité médicale est inséparable de la relation humaine, à la fois singulière dans la rencontre et universelle sur la condition humaine. Les écrivains qui étaient médecins ont illustré la richesse de notre métier.
Le GBO est confronté à des défis majeurs, celui de proposer des solutions à la pénurie : il faut trouver des moyens pour que le temps médical soit optimisé mais en même temps, une médecine de qualité ne peut se concevoir sans la richesse d’une vraie rencontre, dans toute son humanité. La télémédecine et les aides médicales seront des outils incontournables, mais il faut laisser la place à la parole vagabonde et au temps, à l’écoute et aux récits. Car la médecine de qualité est aussi une médecine non-standardisée.
Sur un autre plan, restons conscients que l’activité médicale porte témoignage de la situation réelle de la population et devrait être un interlocuteur de la citoyenneté politique. Là encore le poids de la parole écrite ne peut être négligé.
Même si tout cela semble excéder le rôle d’un syndicat créé sur base de la défense professionnelle, c’est aussi pour rendre leur place au temps et à la relation que le GBO se bat.
.
Dr Lawrence Cuvelier



