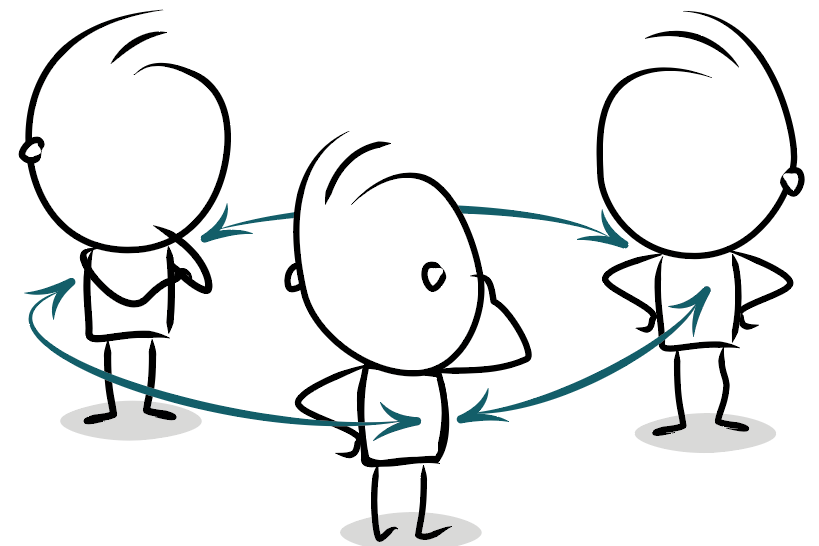
LE GÉNÉRALISTE, TECHNICIEN INTERCHANGEABLE ?
Un billet d’humeur du Dr Lawrence Cuvelier, vice-président du GBO,
publié le 25/03/2022
Il y a bien des gens qui pensent pour nous, qui savent pour nous, qui décident pour nous. Les médecins généralistes sont, parmi les universitaires, ceux qui sont le plus massivement confrontés à un certain réel. Faisant sociologiquement partie du milieu des décideurs, ils peuvent via leurs témoignages infléchir la perception d’une réalité qui est parfois bien déformée par la vision que s’en font les experts. Loin de moi d’exclure toute réflexion globalisante. Toutefois, la médecine n’a pu progresser que quand elle a commencé à se pencher sur des chiffres et des statistiques, et le GBO/Cartel a toujours eu pour objectif d’être rigoureux dans son analyse.
Cependant, se frotter à la réalité permet de rectifier le tir dans certaines prises de position simplificatrices. Parmi les sujets polémiques, nous sommes traversés par un débat qui se poursuit depuis au moins un siècle : le médecin est-il d’abord un technicien interchangeable, ou est-ce la relation qu’il crée avec son patient qui est unique ?
Féconde en mai 68
Cette controverse est traversée par la crise idéologique du 20e siècle, les progressistes se divisant entre deux idoles, Marx ou Freud. Les premiers considèrent le médecin comme un travailleur de la santé, formaté correctement, et remplaçable à la minute même, et l’autre comme un praticien de l’âme se dirigeant péniblement dans les méandres de l’inconscient. Bien que le débat ait perdu de sa virulence, il subsiste toujours en arrière-plan dans la boutique à souvenirs des idéologues politiques.
Lors de la rupture entre Staline et Tito*, ce dernier a prôné une doctrine de l’autogestion en face du dogmatisme stalinien où l’on pensait à votre place. Cette pensée autogestionnaire a été féconde en mai 68, et bien des réalisations d’aujourd’hui en sont les héritières. Ce fut en tout cas le cas dans la dynamique de création des maisons médicales. La plupart des jeunes médecins ignorent tout de cette histoire qui est du passé dont Twitter et Facebook ne parlent guère. Ces idées infusent pourtant encore copieusement dans les débats aujourd’hui.
À Bruxelles, il y a environ 200.000 changements de domicile par an, parmi essentiellement les locataires dont le revenu est peu élevé. Dans cette catégorie de la population, souvent assistée, le soin doit s’inscrire dans la continuité.
La proximité sans pouvoir approcher
La façon dont on conçoit les soins de première ligne illustre parfaitement ce paradoxe. Les autorités ont décidé de bannir chaque jour davantage l’automobile des centres-villes, particulièrement à Bruxelles. ÀA l’objection qu’il est difficile pour les soignants de se déplacer au chevet des patients à mobilité réduite, on oppose une réponse formatée : les centres médicaux doivent prendre en charge les patients locaux exclusivement. Donc voilà le problème de mobilité résolu… d’un trait de plume ! Sauf que c’est loin d’être aussi simple. Quand un patient doit faire un examen complémentaire, il devient de plus en plus compliqué de programmer un déplacement. Il y a encore une série d’arguments qui relèvent du maintien à domicile pour l’aide à la personne et les services qui ne peuvent pas tous être délivrés par vélo. Mais revenons-en au débat qui est escamoté sur l’importance – ou non – du lien entre un médecin traitant et son patient en situation de fragilité.
La continuité, facteur clef
Chaque généraliste est irremplaçable, dans la mesure où une relation particulière s’installe qui ne peut être remplacée. Mais bien sûr il n’est pas indispensable, dans la mesure où une autre relation peut s’instituer entre un patient et un autre médecin ? Cependant, chez les patients les plus fragiles, la pathologie médicale va souvent de pair avec une vulnérabilité sociale. ÀA Bruxelles, il y a environ 200.000 changements de domicile par an et cela concerne essentiellement les locataires dont le revenu est peu élevé. Dans cette catégorie de la population, souvent assistée, le soin doit s’inscrire dans la continuité. Il faut bien souvent des années pour qu’une relation de confiance s’établisse. La continuité constitue donc une donnée cruciale. Déménager dans la commune voisine signifie souvent faire l’objet d’un changement dans les aides locales.
Trop intimes pour être transcrites comme telles
La permanence d’un soignant qui a recueilli les confidences non répertoriées dans les bases de données, et souvent trop intimes pour être transcrites comme telles, est un élément essentiel pour le soutien au patient. Bien sûr, ce n’est pas toujours possible mais est-ce pour autant négligeable ? De la même façon que pour l’accompagnement et le soutien d’un patient face à une pathologie lourde telle un cancer ou une dépression, où parfois le MG a pu aider un malade à ne pas abandonner une relation.
Il existe des pays où la relation est imposée, où le choix du patient est jugé négligeable ou non remboursé, et les performances en matière de Santé publique ne sont pas forcément moins bonnes que dans le nôtre. La Belgique, paradoxalement, garde un bon classement dans la qualité de vie pour l’accessibilité de sa médecine. Ne faut-il pas concilier les données de gestion publique avec un dialogue des gens de terrain ?
Dr Lawrence Cuvelier
——————————————-
* La rupture Tito-Staline, dite également schisme yougoslave, désigne la rupture politique, en 1948, entre l’Union des républiques socialistes soviétiques dirigée par Joseph Staline, et la République fédérative socialiste de Yougoslavie, dirigée par le maréchal Tito.


