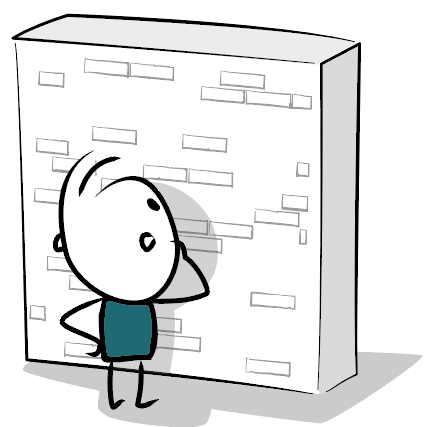
CHAÎNE DE CONFIANCE
Un billet d’humeur du Dr Lawrence Cuvelier, vice-président du GBO,
publié le 28/01/2022
Quand le médecin peine à convaincre le patient, rationnellement, de vérités scientifiques, sa meilleure arme n’est-elle pas de délaisser le registre trop rigoureux pour faire jouer l’humanité, la confiance, le dialogue, l’alchimie… qui ont pu se nouer entre eux ?
Comment caser la médecine dans une boîte à outils ? Notre syndicat soutient évidemment toutes les démarches qui entendent favoriser la communication, la prise de décision partagée rationnelle basée sur des preuves et des traitements dont l’efficacité a été démontrée par des études rigoureuses. Toutefois, le GBO/Cartel est bien conscient que notre métier ne consiste pas en l’application de recettes standard mais qu’il doit tenir compte de la richesse de la rencontre et de la complexité de l’être humain et que l’EBM repose sur les trois piliers, l’évidence scientifique, l’expérience du patient et celle du prestataire.
Deux récents articles illustrent cette exigence.
La confiance est une option de choix quand les arguments rationnels sont inutiles et contre-productifs. La meilleure arme du médecin est de parler avec le patient.
Elizabeth Adler entame son article dans le New England Journal of Medicine comme ceci (*) : « il y a quelques années, quand le contact tactile avec le malade était encore normal, que ce soit palper un abdomen ou presser un stéthoscope sur une poitrine, j’ai rencontré une patiente, une dame de 93 ans. Elle se mouvait difficilement mais parlait rapidement en tigréen, ce qui compliquait la tâche de son interprète. Elle relatait une plainte bien connue des généralistes, surtout venant de personnes âgées : elle avait mal, partout et tout le temps. »
L’interrogatoire systématique fut laborieux. Plus la doctoresse posait de questions, plus la patiente se demandait si son interlocutrice était réellement médecin. Vint le moment de l’examen. La patiente se coucha sur le ventre et, par une sorte d’intuition face à l’incompréhension, la consœur se mit à palper les cervicales et la région scapulaire.
Elle lui demanda si c’était douloureux. La dame répondit que non, que cela lui faisait du bien, et la pria de continuer. Comme le patient suivant s’était décommandé, la consultation se transforma en séance de massage, et elle sentit que les muscles de la patiente se détendaient. Au terme de la session, la patiente était souriante, les douleurs avaient disparu.
La fille de cette personne expliqua que sa mère avait quitté l’Erythrée depuis des années mais que la plupart de la famille était restée là-bas, et qu’elle se sentait bien seule. La patiente, très satisfaite, savait qu’elle avait affaire à un vrai docteur.
Elizabeth Adler recommença ses séances, quand les superviseurs de l’équipe lui recommandèrent de référer la vieille dame au kiné. Mais ce dernier déclina, disant qu’il était surchargé. Le médecin continua donc à suivre la patiente jusqu’à la survenue du covid. Notre consœur, après beaucoup de difficultés administratives, se rendit au chevet de la vieille dame mourante et refit le geste qui l’avait tant soulagée, alors que celle-ci était comateuse, sans avoir la preuve que cela la soulageait encore.
Parler, à défaut de démontrer
Le second récit que nous avons épinglé (**), signé Elvin H. Geng, relate l’expérience déjà ancienne de ce médecin qui prenait en charge un patient atteint de VIH, dans une situation désespérée, avec de multiples complications dont un sarcome. Cette personne, Mr B., vivait sans ressource régulière dans un habitat précaire. Le médecin avait tenté de lui expliquer que les traitements de l’époque étaient efficaces, mais le patient était persuadé que ce n’était pas le VIH qui causait le sida. S’alignant sur les discours tapageurs d’un virologue de l’époque, le Dr Duesberg, dans un discours homophobe, suggérait que c’était le mode de vie des homosexuels qui occasionnaient le sida. Ce virologue fit de nombreux adeptes à cette période, en ce compris le président d’Afrique du Sud du moment, Thabo Mbeki, privant les Sud-Africains d’accès au traitement. De cette prise de position découlèrent des centaines de milliers de morts. La communauté noire américaine justifia le manque de confiance à l’égard de la communauté médicale en affirmant qu’il s’agissait d’une machination montée par la CIA (***).
L’auteur raconte qu’il n’avait jamais rencontré un cas aussi réfractaire que Mr B. Le confrère rendit une nouvelle visite à son patient dans un hospice. Il reformula, en vain, tous les arguments démontrant l’efficacité du traitement. En le quittant, il repensa à ce patient qui n’était ni stupide, ni psychotique. Il analysa les sources de ses propres convictions et de celles de ce monsieur. La confiance du praticien provient de la chaine de confiance que forment professeurs, scientifiques et revues médicales qui évaluent et confirment les éléments de fiabilité. Une validation qui n’existait pas pour Mr B., lequel se fiait à ses relations et à des expériences vécues.
Le Dr Geng retourna voir celui-ci en confessant qu’il n’avait pas vérifié personnellement toutes les données dont il lui avait parlé et que, dans le monde, beaucoup de mensonges subsistaient, mais qu’il s’était occupé de patients dans le même état que lui et qui allaient à présent beaucoup mieux. Il concéda qu’il ne savait pas exactement pourquoi ni comment, mais demanda : ‘est-ce que vous me faites assez confiance pour essayer ?’ A sa grande surprise, le patient accepta et recouvra parfaitement la santé.
Le médecin n’a plus jamais abordé les questions scientifiques avec Mr B. L’auteur préconise d’utiliser la confiance quand les arguments rationnels sont inutiles et contre-productifs. Notre meilleure arme, conclut-il, est de parler avec le patient.
Transparente, l’humanité ?
Si ces deux récits ont valeur d’exemples, c’est qu’ils reflètent peu ou prou une partie de notre expérience de soignant, qui la plupart du temps est indicible et inouïe (non dite et non entendue). Ce genre de considérations n’ont guère de place dans les négociations avec les autorités, ni dans les vérités statistiques. Pourtant, cette humanité des soins est une caractéristique qui fait le charme et la beauté de notre système de santé. Bien qu’au niveau international, l’humanité fasse partie des indicateurs de qualité de vie, elle se retrouve rarement dans les chiffres auxquels le GBO/Cartel est confronté dans les tractations avec l’INAMI et autres administrations de la santé. Elle n’est pourtant pas un détail pour les généralistes. C’est même un point essentiel.
Dr Lawrence Cuvelier
————————————————————————————–
(*) Perspective: a therapeutic relationship N.Eng.J.Med 385/1640-1641
(**) The Doctor’s Oldest Tool, par Elvin H. Geng, N.Eng.J.Med. 386;1 January 6 2022
(***) Bill Gates est plus populaire que la CIA de nos jours !


